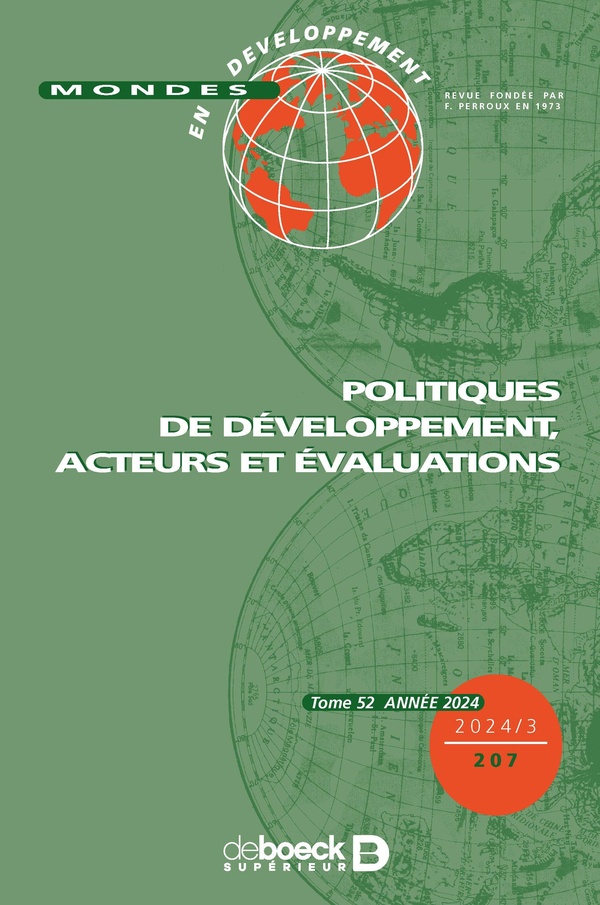
La pratique de la recherche-action a été développée lorsque les chercheuses et chercheurs se sont trouvés devant des problèmes complexes, pour lesquels il n’existait pas de solutions méthodologiques en dehors d’une association avec des acteurs et actrices de terrain, disposant de savoirs locaux et insérés dans des contextes sociaux particuliers. Il en est né des formes hybrides de production de connaissances qui sont particulièrement utiles pour aborder de façon collective une situation problèmatique ou de façon beaucoup plus générale explorer les conditions du changement social. Articuler une logique de recherche et une logique d’action pose des problèmes particuliers à l’évaluation conduisant même à questionner la notion de résultat.
Pour cela, il faut engager une démarche collective, organisée en cycles d’action-réflexion et qui présente de la flexibilité. C’est pourquoi les réalisations peuvent être différentes des objectifs visés initialement par le projet. De ce fait, de nouvelles possibilités sont ouvertes à l’évaluation, qui peut alors s’intéresser à la façon dont une intervention fonctionne et aux efforts déployés par les acteurs pour mobiliser les ressources, réaliser des activités et atteindre les publics visés. Dans ces conditions, quel rôle donne-ton à l’évaluation afin de repérer les freins et les leviers et permettre de piloter l’intervention ?
En support à notre réflexion, nous prendrons l’exemple du projet de recherche-action-participative Arpège, dont l’ambition est d’accompagner des équipes de projets de développement à Madagascar dans l’identification des enjeux de genre et leur prise en compte par des actions expérimentales.