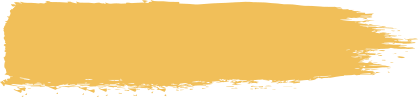Du 19 au 24 juin s’est tenue à Nairobi, la conférence de l’IASC[1] sur le thème : “Les communs que nous voulons : entre héritage historique et actions collectives futures”. L’objectif était d’illustrer la diversité des perspectives et les défis pour les bailleurs, les ONG et les scientifiques dans leur travail autour des « communs[2]. A cette occasion, le Gret, le Cirad et l’AFD ont co-organisé une session afin de partager leurs expériences sur les approches fondées sur les communs en matière de développement territorial. Comment chacune de ces institutions s’empare-t-elle du courant des « communs » ? Comment définissent-elles une « approche par les communs » ? Retour sur les échanges entre ces trois organisations.
Résoudre des dilemmes sociaux et environnementaux complexes
Pour Stéphanie Leyronas, responsable de recherches à l’Agence française de développement (AFD) – seul bailleur de fonds présent à la conférence -, les communs représentent un cadre de compréhension des pratiques collectives dans les pays en développement. Le concept des communs permet d’identifier ces pratiques et d’inspirer les acteurs publics pour résoudre des dilemmes sociaux et environnementaux complexes. L’AFD cherche ainsi à appuyer des entités publiques locales qui soutiennent des « communs ». Si l’approche par les communs est de façon générale positive pour l’institution, cette démarche remet toutefois en question les méthodes et les outils de gestion de l’AFD. Il est en effet très difficile pour une institution financière de soutenir les communs sans leur nuire, notamment en raison de la logique de rationalité économique, juridique et politique d’usage dans une telle institution.
Quatre grands défis ont ainsi été identifiés dans une publication conjointe de l’AFD et de la Banque mondiale. Il s’agit tout d’abord de la nécessité de s’éloigner de l’hypothèse de l’uniformité des institutions pour reconnaître la diversité des pratiques ; mais également d’être capable de passer d’une observation descendante à une approche intégrée, de transformer une culture basée sur les résultats en un processus de soutien et enfin, de passer d’une connaissance « experte » à une connaissance « plurielle ».
Prendre en compte la diversité des pratiques à l’échelle des territoires
Le Cirad, représenté par Aurélie Botta et Etienne Delay, a exposé son engagement pour une coopération territoriale basée sur les communs. La spécificité de l’approche, que cette institution de recherche française développe depuis plusieurs années avec ses partenaires, est de mettre l’accent sur les interdépendances entre les usagers des territoires qu’ils soient humains ou non humains afin de promouvoir les solidarités sociales et écologiques. L’attention portée aux relations, et non à la nature intrinsèque des acteurs, et la posture de « diplomate »[3] en charge de prendre soin de ces relations, sont des éléments essentiels de leur démarche. Ces chercheurs relèvent cinq principales perspectives à leurs travaux : pallier la logique « projet » en changeant les relations entre donneurs, chercheurs et acteurs locaux ; adapter l’approche à la maturité du « faire communs » de chaque territoire ; sécuriser les communs en infiltrant les politiques publiques ; questionner la viabilité des dynamiques que nous accompagnons ; et enfin investir des approches dites sensibles comme celle des attachements. Aurélie Botta termine ainsi sa présentation par la question suivante : « Comment engager les partenaires à remettre en question la pensée dominante pour aller vers une approche plus sensible du vivant, de la biodiversité, voire des relations entre humains et non humains ? ».
Le Cirad a récemment publié un ouvrage sur les communs dans l’aide publique au développement intitulé Les communs. Un autre récit pour la coopération territoriale (2022).
Co-construire des approches avec les acteurs locaux
Enfin, Louisa Desbleds, chargée de recherche-action et doctorante au Gret, a présenté le programme « Communs et gouvernance partagée ». Soutenu par l’AFD, le Gret mobilise depuis 2019 les courants des communs pour comprendre et répondre aux urgences sociales et écologiques dans une quinzaine de situations d’action. Cela implique de construire un cadre opérationnel dans un processus d’aller-retour entre la théorie et la pratique. Le Gret se positionne comme facilitateur engagé politiquement. L’objectif est de co-construire des approches avec les acteurs locaux, en favorisant les conditions de dialogue, d’action et d’apprentissage collectifs entre les acteurs sociaux. Une des spécificités du programme est de travailler sur une diversité de pratiques : gestion des ressources naturelles à Madagascar, au Sénégal et en République Démocratique du Congo, services essentiels au Laos et au Congo-Brazzaville, ou encore aux marchés urbains en Haïti.
Les réflexions critiques au sein du Gret ont permis d’identifier les communs comme une source d’inspiration pour des voies alternatives aux modèles et outils classiques de l’aide au développement, tout en alertant sur les risques de standardisation.

Les défis de l’adoption des communs dans les politiques de l’aide
Partageant la plupart des défis énoncés, les intervenants ont souligné d’autres points d’attention dans l’adoption des communs dans les politiques de l’aide. Notamment, l’enjeu central de l’ajustement des contraintes des projets et des mécanismes de l’aide au développement aux approches itératives et participatives. L’évolution des politiques publiques pour reconnaître et protéger les communs se révèle également cruciale. Enfin, la nécessité de construire des liens entre initiatives aux Suds et aux Nords a été soulevée, avec l’idée que les organisations présentes à la session avaient un rôle à jouer dans cette mise en réseau.
En conclusion, ces échanges ont montré la convergence et la complémentarité des constats et des questionnements entre bailleurs, praticiens et chercheurs, ainsi que la dimension encore exploratoire de ces approches par les communs.
[1] International Association for the Study of the Commons
[2] Le concept des communs a été propulsé par l’attribution du Prix Nobel d’économie en 2009 à Elinor Ostrom, politilogue américaine phare de ce courant et remis au goût du jour dans l’aide au développement française depuis une dizaine d’années.
[3] Expression empruntée à Baptiste Morizot dans son livre Manière d’être vivant (2020)